Cancer chez les 15-39 ans : un signal d’alerte pour la société
- oliviertoma
- 22 mai 2025
- 3 min de lecture
Un constat préoccupant
Entre 2000 et 2020, le nombre de cancers chez les adolescents et jeunes adultes (15-39 ans) a progressé de manière significative en France. C’est le cœur de l’étude menée par Santé publique France, l’Institut national du cancer et le réseau Francim, sur la base de plus de 54 000 cas recensés dans 19 départements.
Ce travail d’une ampleur inédite révèle un taux d’incidence global standardisé de 58,1 cas pour 100 000 personnes-années, avec une hausse moyenne de +1,62 % par an jusqu’en 2014, avant une stabilisation. Certaines pathologies ont particulièrement progressé : les cancers du sein, du rein, du côlon, les lymphomes de Hodgkin, les glioblastomes et même les liposarcomes.
Des spécificités françaises à souligner
La France présente des particularités marquantes. Parmi les femmes jeunes, les cancers du sein représentent plus de 30 % des diagnostics, un chiffre nettement supérieur à celui observé dans d’autres pays d’Europe ou aux États-Unis, où cette proportion reste plus faible à âge comparable. En 2020, chez les femmes de 35 à 39 ans, l’incidence atteignait 31,5 cas pour 100 000 personnes-années, soit une hausse de +1,60 % par an sur 20 ans.
Cet indicateur suggère un phénomène français préoccupant, à explorer à la lumière de nos modes de vie, de notre environnement quotidien, mais aussi de certains facteurs reproductifs (âge plus tardif à la première grossesse, moindre allaitement, etc.).
Agir avant que la maladie ne commence
Cette étude est un signal. Elle nous invite à ne plus penser la prévention uniquement après l’apparition de symptômes ou à l’âge adulte. La vraie prévention doit commencer in utero, dès la grossesse, dès la maternité. Car oui, les expositions précoces façonnent notre santé future.
Tout ce que nous mangeons, buvons, respirons, touchons ou mettons sur notre peau peut interagir avec le développement des cellules chez l’enfant à naître. Ce que les chercheurs appellent l’exposome – l’ensemble des expositions environnementales tout au long de la vie – commence dès les premiers instants de l’existence. Et les perturbateurs endocriniens, les particules fines, les résidus de pesticides, les additifs alimentaires, les plastiques, les solvants, les cosmétiques mal contrôlés sont autant de facteurs silencieux mais puissants de dérèglement biologique.
Une prévention fondée sur la science et le bon sens
La lutte contre les cancers du jeune adulte passe par une transformation des politiques publiques de prévention. Cela implique :
d’informer dès l’école sur l’hygiène de vie, les expositions environnementales, les choix alimentaires ;
de former les professionnels de santé à l’exposome, pour qu’ils deviennent de véritables sentinelles ;
de protéger les femmes enceintes par des messages clairs, accessibles, et des parcours de soins repensés pour limiter les expositions évitables ;
de revoir les politiques d’achat en maternité, en crèche, en restauration collective, pour éviter les plastiques, privilégier le bio et les circuits courts.
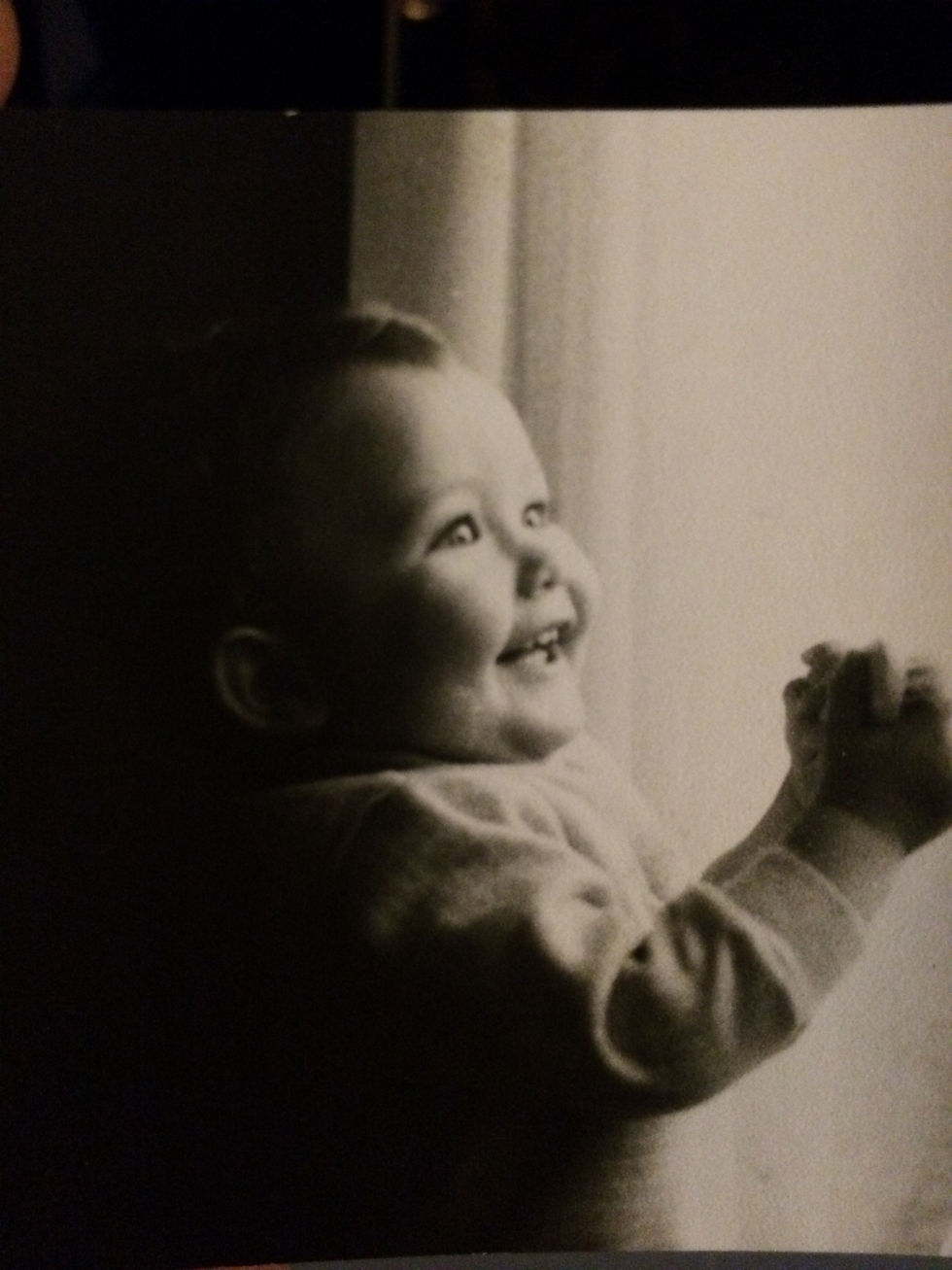
Cette étude nous rappelle une vérité fondamentale : le cancer n’est pas qu’une affaire génétique ou de hasard. Il est aussi, trop souvent, la conséquence de facteurs évitables. Ce n’est pas une culpabilisation, mais un appel à responsabilité collective.
Former nos médecins et nos soignants à la notion d’exposome, c’est leur offrir les clés d’une médecine plus préventive, plus humaine, plus engagée. C’est bâtir un futur où l’on ne soigne pas seulement les maladies, mais où l’on cultive activement la santé.
Nous avons les données. Nous avons les outils. Ce qu’il nous faut maintenant, c’est le courage d’agir ensemble, dès aujourd’hui.



Commentaires