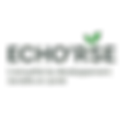RSE4LIFE
Résultats de recherche
146 résultats trouvés avec une recherche vide
- ECHO’RSE- L’actualité du développement durable en santé- Numéro 2- Lundi 25 août 2025.
Introduction Bienvenue dans ce deuxième numéro d’ ECHO’RSE . Notre mission est simple : montrer que le développement durable en santé n’est pas une utopie , mais une réalité déjà en marche dans le monde entier. Optimiser les dépenses, réduire l’empreinte carbone, améliorer la qualité de vie des soignants et assurer la continuité des soins — voilà l’équation gagnante d’une santé durable. Chaque semaine, nous partageons des initiatives inspirantes pour donner envie d’agir. Parce qu’à l’échelle des hôpitaux, des territoires et des politiques publiques, tout est possible si nous décidons de le faire . À la une cette semaine 1. Hôpitaux US : impact environnemental en baisse, économies en hausse Le rapport 2024 de Practice Greenhealth est sans appel : près de 493 hôpitaux partenaires ont généré 203 millions $ d’économies , économisé l’équivalent de 129 piscines olympiques d’eau , détourné des déchets pesant l’équivalent de 1 416 Boeing 747 , et évité 185 000 tonnes de GES .👉 Preuve que écoconception = efficacité économique et environnementale .🔗 Lire le rapport – Practice Greenhealth 2. Soins durables récompensés en Europe Les European Sustainable Healthcare Awards 2025 ont mis en lumière : Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Espagne) pour son projet GREEN BREATH (qualité de l’air hospitalier). Evelyn Brakema (Pays-Bas) , Championne de l’année, pour avoir mobilisé 10 000 professionnels de santé via 230 Green Teams.👉 L’Europe montre que la durabilité hospitalière est un critère de reconnaissance et d’exemplarité .🔗 https://europe.noharm.org/news/sustainable-changemaker-evelyn-brakema-and-dutch-green-health-alliance 3. Transitions de soin plus vertes grâce à l’innovation Trois exemples concrets de transformation durable : En Espagne, SERGAS déploie des ambulances électriques , réduisant de 80 % les émissions et de 97 % les coûts carburant . En Australie, Barwon Health réduit les tests médicaux inutiles , économisant ressources et CO₂. En Égypte, l’hôpital Al-Ramad baisse sa consommation énergétique de 38 % et supprime les appareils au mercure.👉 Des innovations pragmatiques, duplicables partout.🔗 HealthManagement.org 4. Europe : une stratégie santé-climat jusqu’en 2050 La Commission européenne a publié sa Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) sur le lien santé-climat. Objectifs : Adapter les systèmes de santé aux crises climatiques, Réduire les émissions du secteur, Garantir équité et inclusion.👉 La santé devient un pilier central de la transition climatique européenne .🔗 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/climate-change-and-public-health-new-roadmap-research-and-innovation-reduce-risks-2025-06-05_en 5. Australie : 5 gestes pour des soins plus durables L’Université de Melbourne propose un plan d’action concret : Privilégier les traitements oraux aux perfusions IV quand c’est possible. Optimiser le renouvellement d’air en salle opératoire. Passer aux blouses réutilisables. Réviser les dates de péremption trop courtes. Fournir aux médecins un kit d’outils RSE .👉 Du bon sens au quotidien qui génère des économies immédiates et réduit l’empreinte écologique.🔗 https://www.westernhealth.org.au/AboutUs/News/Pages/Sustainability-leader-receives-major-research-grant.aspx Regard Art & Santé Parce que l’art soigne aussi… À Neuchâtel (Suisse), les médecins peuvent désormais prescrire des visites de musées gratuites . Plus de 500 ordonnances culturelles ont déjà été émises dans ce projet pilote, inspiré par un rapport de l’OMS. Une initiative simple, accessible et efficace pour réduire l’anxiété et améliorer la santé mentale . 🌱 Conclusion De l’Espagne à l’Égypte, des États-Unis à l’Australie, la santé durable n’est plus une théorie mais une pratique. Chaque semaine, les preuves s’accumulent : agir pour la santé, c’est agir pour la planète . « Prendre soin de la planète, c’est aussi prendre soin de nous. »
- Quand un hôpital pour enfants devient un modèle de durabilité : l’exemple du CHOC en Californie
En matière de santé, les hôpitaux sont trop souvent perçus comme des lieux de surconsommation énergétique, de production massive de déchets et d’usage intensif de produits chimiques. Pourtant, certains établissements prouvent que l’on peut concilier qualité des soins et exemplarité environnementale. C’est le cas du Rady Children’s Hospital (CHOC) , basé en Californie, qui vient de recevoir pour la deuxième année consécutive le prestigieux Partner for Change Award décerné par l’organisation Practice Greenhealth. https://choc.org/ Un engagement qui dépasse la simple conformité Le CHOC ne se contente pas d’appliquer quelques “écogestes”. Son approche est globale, intégrée à sa stratégie de soins et de management. L’hôpital a mis en œuvre un programme complet de réduction des déchets : tri poussé, réutilisation de matériels dès que la sécurité le permet, et mise en place d’un système de suivi en temps réel pour identifier les gisements les plus importants. Préserver l’eau dans une région en stress hydrique La Californie connaît depuis plusieurs années une sécheresse récurrente. Le CHOC a pris cette contrainte comme une opportunité d’innovation : réduction des consommations grâce à des systèmes intelligents de gestion des flux, réutilisation des eaux grises pour certains usages techniques, et sensibilisation active des équipes soignantes. Résultat : des économies d’eau significatives, et une meilleure résilience face aux aléas climatiques. Sourcing durable et achats responsables Autre pilier de leur démarche : la politique d’achats responsables. Le CHOC privilégie les fournisseurs capables de démontrer leur engagement environnemental et social. Les menus proposés aux enfants intègrent désormais davantage de produits issus de circuits courts et d’agriculture durable, réduisant à la fois l’empreinte carbone et les risques liés aux pesticides. L’élimination progressive des produits toxiques Dans le cadre de ses efforts pour créer un environnement plus sûr, le CHOC a aussi engagé une politique ambitieuse d’ élimination des substances dangereuses utilisées en entretien ou en soins. Produits désinfectants, solvants, plastiques contenant du PVC ou du DEHP sont progressivement remplacés par des alternatives plus sûres pour les patients, les soignants et l’environnement. Pourquoi cet exemple nous concerne en France À l’image des établissements labellisés THQSE en Europe, le Rady Children’s Hospital montre qu’il est possible d’allier excellence des soins et exemplarité environnementale. Le modèle du CHOC démontre que la durabilité n’est pas un luxe, mais un levier de performance . Moins de déchets signifie aussi moins de coûts. Moins d’eau consommée, c’est moins de factures. Des achats responsables, c’est plus de sécurité pour les patients. En France, alors que nos établissements de santé font face à la crise énergétique, à l’épuisement des soignants et aux tensions budgétaires, l’exemple californien nous rappelle que la transition écologique et sociale est indissociable de la qualité des soins . En conclusion Le Rady Children’s Hospital prouve qu’un établissement de santé peut devenir un véritable acteur de la transition écologique , tout en restant centré sur sa mission première : soigner les enfants. Ce double prix n’est pas seulement une reconnaissance, c’est un signal fort envoyé à l’ensemble du secteur : l’avenir des soins passe aussi par la durabilité .
- Haïti montre la voie : quand l’énergie solaire sécurise les hôpitaux ruraux
En Haïti, la fragilité du réseau électrique a longtemps été un obstacle majeur à l’accès aux soins. Les coupures de courant, parfois quotidiennes, rendaient incertain le fonctionnement d’équipements vitaux comme les respirateurs, les incubateurs ou les systèmes de conservation des vaccins. Mais depuis quelques mois, une initiative conjointe des ministères de la Santé et des Travaux publics a changé la donne. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/05/27/improving-healthcare-access-through-renewable-energy Cinq hôpitaux ruraux stratégiques ont été équipés de systèmes photovoltaïques avec batteries de stockage . Résultat : une énergie 100 % fiable , indépendante des générateurs diesel, dont l’approvisionnement était devenu aléatoire dans un pays marqué par la crise logistique. Les bénéfices sont immédiats : continuité des soins assurée même en cas de coupures massives, réduction de la dépendance au diesel , coûteux et polluant, amélioration des conditions de travail des soignants , moins soumis au stress de l’instabilité électrique, et surtout, confiance retrouvée des patients envers des établissements enfin capables de garantir sécurité et fiabilité. Une leçon pour la France Ce qui se joue aujourd’hui en Haïti devrait résonner fortement en France. Car nos hôpitaux, pourtant situés dans une des premières puissances mondiales, ne sont pas exempts de vulnérabilités. La crise énergétique de 2022 a rappelé combien notre système hospitalier restait dépendant d’un réseau centralisé et de sources fossiles. Demain, face au changement climatique , aux canicules et aux tensions sur l’énergie, garantir la résilience des établissements de santé ne sera plus une option, mais une condition de survie. La France dispose d’atouts considérables : géothermie dans de nombreuses régions, solaire abondant sur l’ensemble du territoire, biomasse et récupération de chaleur fatale dans les zones industrielles et urbaines, éolien terrestre et offshore en expansion. Investir massivement dans l’autonomie énergétique des hôpitaux L’exemple haïtien démontre qu’avec une volonté politique claire, l’autonomie énergétique des hôpitaux est possible — et qu’elle sauve des vies. La France devrait saisir cette opportunité pour lancer un plan national d’indépendance énergétique hospitalière , en combinant solaire, géothermie et stockage intelligent. L’enjeu n’est pas seulement environnemental : c’est un enjeu sanitaire et stratégique .Un hôpital qui perd son accès à l’électricité ne peut plus assurer la continuité des soins. Un hôpital autonome en énergie, au contraire, devient un pôle de résilience pour tout un territoire . En résumé Haïti, dans l’adversité, a pris de l’avance. La France, riche de ressources et de technologies, n’a aucune excuse pour ne pas s’engager massivement sur cette voie. Assurer la continuité des soins, c’est aussi investir dans l’énergie du futur.
- Un “GIEC” pour la pollution : quand la science se met au chevet des produits chimiques et des déchets
Il aura fallu plus de trois ans de discussions, de débats diplomatiques et de négociations serrées pour que l’idée devienne réalité. En juin 2025, à Nairobi, les États membres des Nations unies ont officiellement créé un nouveau panel intergouvernemental : l’ ISP-CWP , pour Intergovernmental Science-Policy Panel on Chemicals, Waste and Pollution . Son nom est encore peu connu, mais son ambition est immense : devenir pour la pollution chimique ce que le GIEC est pour le climat, ou l’IPBES pour la biodiversité. Une troisième crise planétaire enfin reconnue Depuis des décennies, la pollution liée aux substances chimiques, aux déchets et aux plastiques progresse dans l’ombre, moins médiatisée que le réchauffement climatique ou l’effondrement de la biodiversité. Pourtant, elle tue. Les chiffres donnent le vertige : près de 9 millions de décès prématurés chaque année seraient liés à la pollution, selon The Lancet . Produits chimiques persistants, plastiques, métaux lourds, déchets toxiques… Le cocktail est planétaire, et ses conséquences frappent la santé humaine autant que les écosystèmes. Avec ce nouveau panel, la communauté internationale reconnaît que la pollution est bien la “troisième crise environnementale mondiale”. Une mission claire : faire le lien entre science et politique À quoi servira concrètement ce nouveau “GIEC de la pollution” ? Sa mission première sera de réunir les meilleures connaissances scientifiques disponibles, de les évaluer et de les rendre compréhensibles pour les décideurs politiques. Comme le GIEC l’a fait en rendant incontestable le diagnostic climatique, l’ISP-CWP devra produire des rapports de référence sur l’état de la pollution chimique et des déchets, mais aussi identifier les menaces émergentes. PFAS — ces “polluants éternels” qui contaminent l’eau et les sols —, microplastiques, polluants organiques persistants, antibiorésistance liée à la pollution… Autant de sujets qui devraient figurer parmi ses priorités. Le panel ne sera pas seulement réactif, il devra aussi être prospectif : capter les signaux faibles, anticiper les risques, alerter les gouvernements avant qu’il ne soit trop tard. Des moyens encore modestes, mais une forte symbolique Le secrétariat du panel sera assuré par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) . Le budget initial, estimé à 8 millions de dollars , reste modeste au regard des enjeux. Mais le symbole est puissant : les Nations unies donnent un statut officiel à la lutte contre la pollution, et placent la science au centre du débat. La question sensible des conflits d’intérêts Derrière l’enthousiasme, une vigilance s’impose. Le secteur chimique est l’un des plus puissants au monde, et l’histoire regorge d’exemples où l’industrie a cherché à freiner la régulation. Dès 2023, plusieurs ONG avaient dénoncé la présence de représentants de multinationales comme Chevron, Veolia ou encore de fédérations industrielles au sein d’un groupe consultatif technique du PNUE. Un signal d’alarme qui oblige aujourd’hui à penser des règles strictes : transparence, déclaration des intérêts, voire exclusion totale de certaines parties prenantes, à l’image de ce que l’OMS a fait dans sa convention contre le tabac. La crédibilité du panel en dépend. Un calendrier qui s’accélère L’histoire a commencé en 2022, quand l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement a adopté une résolution appelant à la création de ce panel. Après plusieurs sessions préparatoires, le texte fondateur a été adopté en juin 2025. La première plénière du panel devrait se tenir d’ici quelques mois, avec pour objectif de définir son mode de fonctionnement, son bureau scientifique et les premiers thèmes de rapport. Vers un triptyque mondial : climat, biodiversité, pollution Avec le GIEC, l’IPBES et désormais l’ISP-CWP, les trois grandes crises planétaires — climat, biodiversité, pollution — disposent chacune d’une interface science-politique dédiée. Le défi sera de faire dialoguer ces panels entre eux, car les crises s’alimentent mutuellement. La pollution fragilise les écosystèmes, qui eux-mêmes perdent en résilience face au climat. Un signal fort pour la santé et les générations futures Pour les acteurs de la santé et de la RSE, la création de ce “GIEC de la pollution” est une nouvelle d’importance. Elle signifie que les États reconnaissent enfin que l’enjeu n’est pas seulement environnemental mais aussi sanitaire, social et économique. Les premières publications du panel seront scrutées de près : elles pourraient devenir les boussoles de politiques publiques ambitieuses, mais aussi de stratégies d’entreprises responsables. En un mot, ce panel est une opportunité historique : transformer la science en levier de décision, donner de la visibilité à des pollutions trop longtemps invisibles, et placer la santé des générations futures au cœur de l’action internationale.
- ECHO’RSE -L’actualité du développement durable en santéNuméro 1 – Lundi 18 août 2025
Bienvenue dans ce premier numéro d’ ECHO’RSE® .Chaque semaine, nous mettrons en lumière des initiatives, innovations et réglementations qui montrent que le développement durable en santé n’est pas une option, mais une chance : optimiser les dépenses, réduire les impacts, améliorer le bien-être des soignants et préserver les ressources naturelles. Notre ambition est simple : donner envie d’agir . Montrer que tout est possible. Car si le secteur de la santé ne montre pas l’exemple, qui le fera ? 1. ESPR : l’éco-conception bientôt obligatoire pour presque tous les produits La nouvelle réglementation européenne sur l’éco-conception ( ESPR – Eco-design for Sustainable Products Regulation ) va s’appliquer à la quasi-totalité des produits (hors alimentation et médicaments).Objectifs : durabilité, réparabilité, circularité , et mise en place d’un passeport numérique produit pour garantir la traçabilité environnementale. 👉 Un changement qui impactera aussi les dispositifs médicaux, le mobilier hospitalier ou les équipements de laboratoire .🔗 Lire https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en 2. Des économies colossales grâce à la durabilité hospitalière aux États-Unis En 2024, près de 500 hôpitaux américains ont prouvé que durabilité rime avec efficacité.Résultats : 203 millions $ économisés en un an 185 000 tonnes de CO₂ évitées Une baisse significative de la consommation d’eau et des déchets. 👉 Une preuve concrète que la transition verte peut renforcer la résilience économique des établissements de santé.🔗 Source https://practicegreenhealth.org/ 3. Récompenses européennes pour les champions de la santé durable Les European Sustainable Healthcare Awards 2025 ont distingué deux acteurs inspirants : Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Espagne) pour son projet GREEN BREATH , axé sur la qualité de l’air hospitalier. Evelyn Brakema (Pays-Bas), sacrée Sustainability Champion of the Year pour avoir mobilisé 10 000 professionnels de santé au sein de 230 Green Teams . 👉 L’Europe valorise et amplifie les projets qui ouvrent la voie.🔗 Source https://europe.noharm.org/news/2025-european-sustainable-healthcare-awards-reveal-years-champions 4. Financements records pour réinventer les dispositifs médicaux L’Union européenne vient de débloquer 403 millions d’euros pour soutenir l’innovation dans les dispositifs médicaux intégrant le numérique et l’intelligence artificielle.Objectifs : Générer 826 millions d’euros d’investissements privés Créer plus de 800 emplois qualifiés Développer des dispositifs plus sûrs, plus sobres, et plus connectés. 👉 Un signal fort pour réorienter l’innovation vers la santé durable et numérique . https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en 5. Sanofi passe l’éco-conception au cœur de ses produits Dès 2025 , tous les nouveaux médicaments et vaccins de Sanofi seront conçus selon des principes d’ éco-conception .Objectif : étendre cette approche responsable à leurs 20 produits les plus vendus d’ici 2030 . 👉 Une première mondiale dans l’industrie pharmaceutique, qui montre que les géants du médicament peuvent intégrer la durabilité dès la recherche et développement .🔗 Source https://www.sanofi.com/en/magazine/sustainability/how-eco-design-makes-for-a-healthier-and-more-sustainable-world-healthcare Zoom Art & Santé À San Diego (USA), des médecins vont prescrire dès septembre des ordonnances culturelles : visites au musée, théâtre ou danse, destinées aux jeunes souffrant d’anxiété ou d’isolement.Une initiative inspirée du modèle britannique de prescription sociale , qui démontre encore une fois que l’art soigne, apaise et élève . 🔗 Source – San Diego Union-Tribune Conclusion Ce premier numéro d’ ECHO’RSE illustre bien notre conviction : les solutions existent déjà , en Europe comme à l’international.À nous de les partager, de les amplifier, et surtout de les mettre en œuvre dans nos établissements. « Il n’y a pas de petites actions, seulement des graines d’avenir. »
- ENKORE : l’Europe bâtit un cadre d’éco‑conception pour les dispositifs médicaux
Et si la prochaine révolution de la santé venait… de la conception même des dispositifs et de leurs emballages ? C’est exactement l’ambition d’ ENKORE , un projet européen financé par l’Innovative Health Initiative (IHI) qui vise à réduire l’empreinte environnementale du secteur en créant un cadre d’éco‑conception spécifiquement adapté aux dispositifs médicaux à usage unique et à leurs packagings — en respectant, bien sûr, les exigences de sécurité et de stérilité propres au médical. IHI Innovative Health Initiative Ce que prépare concrètement ENKORE Le projet met au point un “outillage” complet pour guider industriels, hôpitaux et décideurs : des catalogues de matériaux et solutions (KEM : Key Enabling Materials / KES : Key End‑of‑cycle Solutions ) afin de minimiser les déchets , optimiser l’usage des ressources et réduire l’empreinte carbone , tout en garantissant la sécurité clinique ; un Digital Product Passport (DPP) pour la traçabilité et la fin de vie des produits ; des évaluations environnementales et sociales sur le cycle de vie ( ELCA / SLCA ) pour mesurer les impacts de bout en bout. Le cadre n’est pas qu’un document : il sera testé dans 5 systèmes de santé régionaux en Europe , au fil d’ usages réels couvrant des familles critiques : dispositifs d’injection , consommables de dialyse , packagings plastiques et cellulosiques , et filières de déchets (y compris infectieux) en hôpital . IHI Innovative Health Initiative Qui porte ENKORE, avec quels moyens ? ENKORE est un consortium public‑privé piloté côté académique par l’ Universidad Politécnica de Madrid et, côté industriel, par Medtronic . Il réunit plus de 39 partenaires et 13 membres associés , sur la période 2025‑2028 (grant IHI n° 101166707 ), avec un financement combinant apport public IHI et contributions de l’industrie et de partenaires associés. Universiteit Leiden CORDIS Parmi les partenaires de la sphère publique/territoriale figure EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities), qui contribuera à l’ ancrage territorial du cadre et à sa mise à l’épreuve dans des régions de santé — clé pour passer de la théorie aux pratiques d’achat et d’organisation. euregha.net +1 Pourquoi c’est stratégique pour les hôpitaux et les acheteurs Le verrou historique de la circularité en santé, c’est la stérilité et la biocompatibilité : on ne peut pas remplacer un matériau ou introduire du recyclé “comme dans l’automobile”. ENKORE attaque le problème là où il se joue : au design , en connectant dès l’amont les choix de matériaux aux scénarios de fin de vie (réemploi sécurisé, recyclage matière ou chimique, valorisation dédiée, collecte au domicile pour les patients en auto‑soins, etc.). Pour les hôpitaux/CHU, cela annonce des gains très concrets à horizon court/moyen terme : spécifications d’achat fondées sur des matériaux et designs validés environnementalement (KEM/KES) ; traçabilité et conformité facilitées par le DPP ; ACV/ASCV (ELCA/SLCA) prêtes à l’emploi pour comparer des alternatives et justifier les choix (qualité‑coût‑durabilité). Et maintenant ? Le site officiel ENKORE présente les use‑cases au fil de l’eau et centralise l’avancée des travaux (matériaux, DPP, méthodologies). Pour les directions achats, biomédicales et développement durable, c’est la page à suivre pour s’aligner progressivement, tester des pilotes et anticiper l’industrialisation. Enkore Eco Healthcare En France ? La dynamique européenne d’ENKORE trouve en France un terreau déjà fertile.Il y a cinq ans, un projet novateur avait été présenté à l’ANAP et à la DGOS : le développement, avec le soutien financier de l’ ANFH , d’un logiciel d’éco-conception des soins destiné à être mis à disposition en open source de tous les établissements de santé français.Objectif : outiller concrètement chaque hôpital, clinique et structure médico-sociale pour décliner l’éco-conception dans leurs pratiques quotidiennes, de l’achat aux soins. Grâce à des partenariats actifs — auxquels nous avons contribué — cette initiative a vu le jour et illustre que la France garde souvent un train d’avance sur la RSE en santé… et pas seulement sur le papier : sur le terrain, dans des solutions opérationnelles et réplicables .. https://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/eco_conception_des_soins.pdf
- Microgrid hospitalier : l’exemple de Kaiser Permanente inspire l’hôpital de demain (en France aussi)
En Californie, le centre médical de Kaiser Permanente à Ontario vient d’inaugurer le plus grand microgrid hospitalier à énergie renouvelable aux États-Unis. Avec deux mégawatts de panneaux solaires, une capacité de stockage non lithium de neuf mégawattheures et une pile à combustible de un mégawatt, cette installation offre au site une autonomie énergétique sans précédent. En cas de coupure, le microgrid couvre jusqu’à dix heures d’alimentation d’urgence, tout en réduisant drastiquement les coûts et les émissions de CO₂. Cette solution fait désormais figure de modèle pour imaginer la santé de demain, résiliente, sobre, et durable. https://about.kaiserpermanente.org/news/press-release-archive/pioneering-renewable-energy-solutions Le microgrid en question fonctionne de façon intelligente : lorsqu’il y a surplus d’énergie solaire ou que le courant de réseau est à bas prix, l’électricité est stockée. À l’inverse, lors des pics tarifaires, le microgrid libère son énergie cumulée, réduisant ainsi la dépendance au réseau classique. Cette architecture hybride – solaire, stockage et pile à combustible – incarne un virage technologique clair vers une santé respectueuse de l’environnement et des ressources. https://greenbuildingnews.com/2025/04/23/kaiser-permanente-debuts-nations-largest-hospital-based-microgrid/ Une batterie non lithium, de type zinc-brome, est utilisée ici. Moins risquée, durable et au cycle de vie plus vertueux, elle incarne la sobriété technique que nous devons privilégier dans les équipements de santé. https://www.power-eng.com/onsite-power/microgrids/california-hospital-unveils-solar-storage-microgrid/ Et en France ? Le marché du microgrid en France , notamment le « Microgrid as a Service », est en forte progression. Il était estimé à environ 60 millions USD en 2024, avec une trajectoire à 8 % de croissance annuelle d’ici 2035. Cette montée en puissance est soutenue par une feuille de route volontariste pour la décarbonation, l’intégration de stockage et les politiques publiques encourageantes. https://www.marketresearchfuture.com/reports/france-microgrid-as-a-service-market-60984 Aujourd’hui, les grands acteurs français – EDF, Schneider Electric, Engie – investissent massivement dans les microgrids urbains, industriels ou hospitaliers. Des pilotes émergent, comme sur l’Île d’Yeu, où un microgrid communautaire automatisé enlace des maisons, panneaux solaires et stockage pour garantir sécurité énergétique décentralisée. Une adaptation possible, une opportunité à saisir Imaginer un microgrid hospitalier en France, c’est penser nos toits, parkings, façades solaires couplés à du stockage local (batteries vertes, pile à combustible, stockage thermique…).Cela permettrait : Une sécurité énergétique renforcée (canicule, coupures, incendies) Une réduction mesurable du coût de fonctionnement Une faible empreinte environnementale Une illustration concrète de la transition écologique dans le soin Avec des appels à projets, des incitations locales (BPI, ADEME, collectivités), et des partenariats industriels, cette idée devient réaliste et urgente. En résumé Ce que vous voyez en Californie n’est pas un rêve lointain. C’est une réalité applicable. Joseph Kaiser l’a expérimenté. Et si nous nous donnions les moyens d’en faire un projet pilote, en Île-de-France, dans les DOM, en PACA ? Le soin de demain ne se joue pas seulement dans les actes médicaux. Il se joue aussi dans la manière dont on les alimente et les insère dans nos territoires. L’exemple de Kaiser est une boussole. À nous de la suivre.
- Chaleur extrême en Europe : l’urgence d’une adaptation sanitaire… et d’une mobilisation citoyenne
The Guardian titrait encore ce matin sur la vague de chaleur qui frappe l’Europe : des records historiques tombent les uns après les autres, et avec eux des vies s’éteignent prématurément. Les chiffres sont froids — paradoxalement : surmortalité en hausse, hospitalisations pour déshydratation et accidents vasculaires cérébraux, feux de forêts incontrôlables. Dans les hôpitaux, la riposte se met en place : activation des plans chaleur, création d’îlots de fraîcheur, adaptation des protocoles “canicule”, sécurisation de l’alimentation électrique face aux pics de consommation, repérage systématique des publics les plus vulnérables. C’est ce que les experts appellent des mesures “no-regret” — indispensables, quelles que soient les incertitudes climatiques. Mais au-delà des dispositifs techniques et des plans institutionnels, deux questions reviennent dans toutes les conversations : « Comment agir ? » et « À quoi ça sert, à mon niveau, si je suis tout seul ? » C’est l’ombre du monstre invisible : le “A QUOI BON ?” . Et pourtant, il y a une réponse. Avec notre équipe, nous avons planché sur des solutions qui dépassent la simple indignation. Nous sommes arrivés à une évidence : si la réponse passe par l’engagement des États, des collectivités et des entreprises (sur lesquels, soyons honnêtes, nous avons peu de prise si nous ne sommes ni ministre, ni maire, ni dirigeant), elle réside aussi dans l’engagement individuel . C’est ce que nous appelons la RSI — Responsabilité Sociétale Individuelle . Imaginez une dynamique où chacun d’entre nous engage 10 autres personnes dans une démarche positive et concrète. Puis,... que chacune de ces 10 personnes en motive 10 autres à son tour.C’est l’effet 10 puissance 10 : en 2030, ce sont plusieurs milliards d’individus qui pourraient être touchés, mobilisés, agissants. C’est l’esprit de la charte “Ambassadeur 2030 – 10 puissance 10” .Un engagement simple, ouvert à tous, qui transforme le découragement en action, l’isolement en mouvement collectif. 📄 Découvrez et signez la charte ici : https://www.agenceprimum.fr/10-puissance-10-la-responsabilite-societale-individuelle-rsi-accessible-a-tous/ Changer le monde n’est pas réservé aux décideurs. C’est un choix, une addition de gestes et de relais. Nous pouvons être acteurs plutôt que victimes . La chaleur extrême nous met face à un choix de société. À nous de jouer.
- 🌍 Tour du monde de la RSE en santé : et si la rentrée 2025 était régénératrice ?
C’est l’été. Le temps ralentit, les réunions se figent, les esprits prennent le large. Et pourtant, pendant que certains ferment temporairement les portes de leurs services, d’autres, partout sur la planète, en ouvrent de nouvelles. Des portes qui mènent à des hôpitaux plus durables, des soins plus sobres, des innovations au service du vivant. Ce que l’on appelle RSE en santé – parfois de manière abstraite – prend, ailleurs, des formes concrètes, puissantes, inspirantes. Prenons d’abord le large vers le Royaume-Uni. Le NHS, ce système de santé qui fut jadis pionnier du soin pour tous, vise désormais un autre objectif révolutionnaire : devenir le premier service de santé au monde à atteindre la neutralité carbone. Oui, un système hospitalier “net zéro”. Derrière cette ambition, des actes. Le programme Greener NHS transforme les achats, les prescriptions, l’alimentation, les transports, les équipements. Il touche aussi bien le bloc opératoire que la cuisine, les médecins que les patients. Et il inspire : à l’international, cette audace devient un étendard. Plus au sud, en Égypte, un hôpital situé dans une zone à faibles ressources a réussi à mettre en œuvre presque tous les objectifs du Global Green and Healthy Hospitals. Réduction des déchets, circuits courts alimentaires, énergie solaire, traitement des effluents… Ici, la RSE ne rime pas avec moyens, mais avec engagement. Ce n’est pas une affaire de luxe, c’est une question de survie. Et cela fonctionne. En Inde, un autre mouvement est à l’œuvre. L’IIT Indore, prestigieux institut technologique, a lancé deux formations visionnaires : l’intelligence artificielle appliquée à la santé d’un côté, l’économie environnementale de l’autre. Ce croisement est tout sauf anodin. Il prépare une nouvelle génération de professionnels capables de penser soin, environnement, efficacité et sobriété dans un même geste. Et ce n’est pas de la théorie : l’établissement a ouvert un centre de bio-manufacturing durable, pour produire localement des médicaments à plus faible empreinte. Outre-Atlantique, les chiffres parlent. Aux États-Unis, le réseau Practice Greenhealth a mesuré les résultats concrets d’une RSE intégrée dans le soin : plus de 200 millions de dollars économisés, 185 000 tonnes de CO₂ évitées, des milliers de tonnes de déchets détournées, des millions de litres d’eau préservés. Des hôpitaux moins polluants. Des comptes plus sains. Et des patients mieux pris en charge. Au Royaume-Uni encore, une innovation pourrait bouleverser un pan entier de la médecine respiratoire. L’inhalateur Quattrii, actuellement en phase de test, promet d’être sept fois plus efficace que les dispositifs actuels, tout en supprimant les gaz propulseurs polluants. Une petite révolution discrète, mais potentiellement décisive. Et puis, il y a l’humain. Le personnel. Les formations. En France, au Danemark, au Royaume-Uni, des modules de formation en santé durable se développent à grande vitesse. Car si la transformation est technologique, elle est avant tout culturelle. C’est dans les gestes du quotidien que se loge la bascule. Une perfusion plus juste, un tri des déchets plus rigoureux, un diagnostic plus pertinent, un transport évité : chaque détail compte. Ce tour du monde n’est pas une carte postale. C’est une invitation. Une preuve que la transformation est possible, déjà en marche. Et qu’il ne tient qu’à nous de l’accélérer, de la contextualiser, de la rendre désirable ici aussi. Alors que nos cerveaux se mettent en mode pause, pourquoi ne pas les nourrir de ces récits inspirants ? Pourquoi ne pas envisager une rentrée 2025 non pas comme un retour à la routine, mais comme un élan ? Une rentrée régénératrice, fertile, vivante. Et si nous choisissions de soigner autrement — les patients, bien sûr, mais aussi nos systèmes, nos ressources, notre avenir commun ? Bonnes vacances. Et que cette trêve estivale devienne le terreau d’un renouveau.
- HAS 2025–2030 : quand la santé soigne aussi la planète
Il y a des signaux faibles qui, s’ils passent inaperçus dans le flot des actualités, n’en sont pas moins porteurs de basculements majeurs. La publication de la stratégie 2025–2030 de la Haute Autorité de Santé (HAS) en est un. Derrière ce document institutionnel se cache une ambition nouvelle : intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans l’ensemble des missions de cette autorité publique indépendante. Ce virage, amorcé en 2024 avec la publication de la première feuille de route Santé-Environnement, se confirme désormais à tous les étages : recommandations, certification, évaluation des pratiques, promotion de la qualité, prévention… Tous les leviers sont appelés à se réorienter vers une santé qui soigne sans polluer, une santé alignée sur les limites planétaires. Au cœur de cette stratégie, un principe fort émerge : la nécessité d’écoconcevoir les soins, les parcours et les technologies médicales. L’idée n’est plus seulement de garantir l’efficacité thérapeutique d’un acte ou d’un dispositif, mais aussi d’évaluer son impact sur l’environnement, sa consommation énergétique, la gestion de ses déchets, et sa soutenabilité dans le temps. À travers ses futurs référentiels de certification et ses recommandations de bonnes pratiques, la HAS entend intégrer des critères de sobriété, de durabilité, de moindre exposition pour les patients comme pour les professionnels. Plus encore, la feuille de route environnementale de la HAS appelle à repenser les parcours de soins dans leur globalité. Cela implique d’agir sur les déterminants environnementaux de la santé (qualité de l’air, de l’eau, bruit, exposition aux substances chimiques), mais aussi de soutenir les établissements de santé dans leur propre transition. Des indicateurs de performance environnementale des soins pourraient être intégrés aux outils d’évaluation. Des incitations à la réduction des pollutions médicamenteuses, à la limitation du plastique à usage unique ou encore à la maîtrise des effluents hospitaliers sont envisagées. Un autre pan essentiel de cette stratégie concerne la santé au travail. Les professionnels de santé sont exposés quotidiennement à des substances toxiques, à des niveaux sonores élevés, à des contraintes physiques et à des tensions psychiques. La HAS souhaite renforcer la prévention des risques professionnels, notamment les expositions aux perturbateurs endocriniens, les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux. Ces aspects ne seront plus relégués à la marge, mais intégrés aux référentiels de qualité, en lien avec la qualité de vie au travail. Enfin, la stratégie 2025–2030 de la HAS affiche une volonté d’alignement fort avec les grandes orientations nationales et internationales. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan National Santé Environnement (PNSE 4), de la Stratégie Nationale de Résilience du Système de Santé, et des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Elle entend jouer un rôle d’appui auprès des autres institutions (CNAM, DGOS, agences sanitaires) pour porter une vision globale, cohérente et résolument tournée vers une santé durable. Il y a encore du chemin. Mais la direction est tracée. La HAS ne révolutionne pas brutalement notre système de santé, elle en ajuste la boussole. Vers une médecine plus sobre, plus préventive, plus consciente de ses impacts. Vers une pratique du soin qui protège, soigne… et préserve. Sources officielles Stratégie 2025–2030 de la HA S (PDF officiel) Feuille de route Santé-Environnement de la HAS
- Nuisances sonores : un coût social colossal et un enjeu de santé publique à intégrer dans les politiques d’achats
Le bruit chronique issu du trafic routier, ferroviaire ou aérien est bien plus qu’une simple gêne : c’est un risque sanitaire majeur, largement sous-estimé. L’ Agence Européenne pour l’Environnement (EEA) compte plus de 110 millions de personnes exposées à des niveaux de bruit nocifs en Europe, entraînant 66 000 décès prématurés par an , 50 000 cas de maladies cardiovasculaires et 22 000 cas de diabète de type 2 https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/24/noise-pollution-harms-health-of-millions-across-europe-report-finds 💶 Un coût économique et social insoutenable En Europe, le fardeau annuel de ces nuisances est estimé à 95,6 milliards d’euros (0,6 % du PIB), sans compter leur incidence sur le bien-être et la productivité https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/europeans-exposed-to-harmful-noise-pollution-levels En France, une étude de l’ADEME et du CNB chiffre le coût social national à environ 147 milliards d’euros par an , dont dysfonctionnements cardiovasculaires, troubles du sommeil et diabète Wikipédia . En Île‑de‑France, le seul bruit des transports pèse pour 35,8 milliards €/an : avec 4,5 millions de personnes gênées, 1,4 million affectées par des troubles du sommeil, et des coûts liés à la cognition, la santé mentale ou le diabète : https://www.bruitparif.fr/pages/En-tete/500%20Innovation%20et%20recherche/700%20Publications%20scientifiques/2022%20-%20Social%20cost%20of%20noise.pdf Les dépenses prises en charge par l’assurance maladie liées au bruit s’élèvent à environ 200 millions € par an en Île‑de‑France — à multiplier au niveau national 🧠 Effets sanitaires : au-delà de la nuisance Le bruit chronique déclenche une réponse de stress physiologique permanente, favorisant l’ hypertension , les maladies cardiaques , le diabète , les troubles cognitifs chez les enfants et l’ anxiété https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/environmental-noise-in-europe-2025 Il diminue la concentration, l’apprentissage scolaire, et peut entraîner une diminution de l’activité physique , contribuant au surpoids ou à l’obésité. 💼 Civisme & responsabilité au travail Lutter contre le bruit, c’est prendre en compte le bien-être de ses salariés, clients ou riverains : Choisir des équipements performants en niveau sonore , intégrer ce critère dans les achats durables. Sensibiliser dès l’école — et former dans les métiers exposés (éducation, santé, transports, hôtellerie, restauration). 📘 Pourquoi c’est un sujet de santé publique Traiter les nuisances sonores, ce n’est pas un geste accessoire : c’est un geste de santé publique . Réduire les sources de bruit contribue à diminuer les coûts indirects, les pathologies chroniques, et à améliorer la qualité de vie collective. 🛠️ Que faire concrètement ? Intégrer le critère décibel dans les appels d’offre. Favoriser l’ urbanisme sonore : zones de silence, aménagements acoustiques, limites de vitesse, transports doux. Former et sensibiliser dès la formation initiale (enseignants, soignants, conducteurs, etc.). Mettre en place des mesures annuelles . ✅ En résumé Le bruit n’est pas seulement une nuisance : c’est une cause majeure de dépenses publiques , de pathologies évitables, de perte de productivité et de lien social. Combattre le bruit revient à : protéger la santé, réduire les coûts de l’assurance maladie, améliorer les conditions de travail, et favoriser une politique d’achats vraiment responsable.
- Pourquoi la finance doit protéger la biodiversité : au-delà de l’écologie, une question de santé et de survie
En juillet 2025, la Fédération Bancaire Française (FBF) a publié un mémo actualisé qui illustre un tournant majeur : les institutions financières françaises commencent à intégrer la biodiversité dans leurs décisions d’investissement, en lien avec les obligations de la taxonomie européenne et des cadres ESG Fédération bancaire française . 🌱 Un enjeu systémique, pas un acte militant Protéger la biodiversité n’est pas une posture écolo‑branchée : c’est un impératif pour préserver nos matières premières (plantes médicinales, biomatériaux, pollinisateurs…), nos aliments , l’eau, l’air, les sols — tous dépendants de la santé des écosystèmes. Les découvertes de nouveaux médicaments viennent encore majoritairement du vivant — la nature est la première source de la pharmacopée mondiale. 🏦 Le rôle essentiel du secteur financier Les banques françaises s’engagent désormais à financer des projets de restauration écologique , à cartographier les risques liés à la perte de biodiversité de leurs portefeuilles, et à orienter des capitaux vers des acteurs responsables Fédération bancaire française Fédération bancaire française . Le PNUD, via l’initiative BIOFIN , accompagne les États pour combler le déficit de financement de la nature d’environ 700 milliards $ par an , en mobilisant le secteur privé et public de manière innovante. 🧭 En pratique : Diag Biodiversité et financement BPI Bpifrance, avec l’Office français de la biodiversité (OFB), propose un outil appelé Diag Biodiversité . Ce dispositif permet aux PME de : analyser leurs impacts et dépendances à la biodiversité, élaborer un plan d’action opérationnel, et bénéficier d’un financement (jusqu’à 40 %) pour ce diagnostic. https://www.agenceprimum.fr/wp-content/uploads/2025/06/Diagnostic-biodiversite.pdf Cette approche garantit un diagnostic robuste , limite le greenwashing, et rassure le financeur, l’entreprise et toute la chaîne de valeur . ✅ En conclusion Intégrer la biodiversité dans les décisions d’investissement n’est pas une concession : c’est une stratégie essentielle. C’est reconnaître que notre santé, notre alimentation, notre pharmacopée, notre eau et donc notre futur sont inséparables des écosystèmes . Le secteur financier a une responsabilité centrale : soutenir des projets structurellement engagés , éviter le greenwashing, et valoriser les démarches crédibles comme le Diag Biodiversité.C’est ainsi que la finance devient un levier fort de santé durable et de résilience écologique.